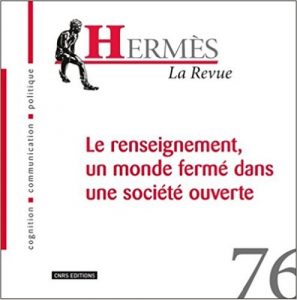09/11 – 11/09. Ceci n’est pas un code secret mais deux dates de notre histoire contemporaine qui ont donné le top départ d’une ère globalisée synonyme de nouvelles opportunités mais aussi de nouvelles menaces et sonné le glas d’un vieux monde bipolaire où la complexité n’était encore qu’un concept. Dans ce contexte, les services de renseignement que l’on a cru un instant voir s’effacer avec la fin de la guerre froide ont, au contraire, pris une importance sans égale dans l’histoire de l’humanité, au service des décideurs mais aussi des citoyens qui les financent : ouverture du renseignement, ouverture au renseignement.
En une génération, la mutation de ce monde secret, source de bien des fantasmes et idées reçues, s’est opérée. Une première étape a ainsi été franchie non sans mal : accroissement des budgets des services, arrivée de nouveaux profils, développement des capacités technologiques,… Mais une autre étape doit désormais prendre le relai tant il est devenu évident que les dispositifs actuels n’ont pas l’agilité de ceux de leurs adversaires : réseaux terroristes, organisations criminelles, hackers, … Et de ce point de vue, les analyses se suivent et se ressemblent sans que les mesures prises ne semblent régler totalement les failles pourtant relevées. Pourquoi ? C’est ce qu’analyse en une vingtaine d’articles et autant de contributeurs le n°76 de la revue Hermès intitulé : Le renseignement : un monde fermé dans une société ouverte.
Pour comprendre cette paralysie relative (l’agilité des uns faisant la paralysie des autres et réciproquement), il faut tout d’abord planter le décor de ce qui apparaît être une véritable mutation anthropologique. Ce décor est celui d’un monde digital qui offre à chacun des capacités de renseignement, de communication et d’influence inédites et qui imposent de ne plus penser le neuf avec l’ancien. Daech aurait-il pu se développer sans les réseaux sociaux ? Comment la justice devra t-elle gérer la mise en ligne de millions de décisions qui permettra de comparer (et peut-être même de prédire) les jugements ? A l’ère des fameux Big Data, qui en sait finalement le plus : la NSA ou Google ? Loin d’avoir le monopole de la surveillance, les services d’Etat doivent désormais composer avec des logiques dites de « sousveillance », à l’instar des policiers filmés systématiquement par les manifestants. Sans oublier ces fameux lanceurs d’alerte qui peuvent – à tort ou à raison – déstabiliser des entreprises comme des Etats. Et tout cela dans des sociétés où les comportements oscillent du voyeurisme au narcissisme. Big Brother n’est plus, supplanté par Little Brothers, étendu, multiple et insaisissable.
Dès lors, donner au renseignement la place qui lui revient – et notamment ses lettres de noblesse académique – n’est pas seulement un gage d’efficacité. C’est également un impératif démocratique qui implique des réflexions mêlant les approches pratiques des professionnels et les analyses théoriques des académiques. Ainsi : que vaut une analyse rationnelle face à des individus ou organisations qui sont sur le registre du symbolique et font primer la célérité sur la véracité ? Dans un monde globalisé et multiculturel, comment comprendre l’adversaire et même tout simplement le repérer ? Aux réseaux doivent répondre des réseaux, réseaux qui allient connaissance et action, créativité et réactivité. Avec un défi de taille : marier le monde du confidentiel et du secret à celui de l’information ouverte et de la communication.
A lire : N° 76 de la revue Hermès coordonné avec Franck Bulinge.
 A écouter : Midi Magazine du 21 février 2017 présenté par Philippe Arondel
A écouter : Midi Magazine du 21 février 2017 présenté par Philippe Arondel
Midi Magazine du 21/02/2017