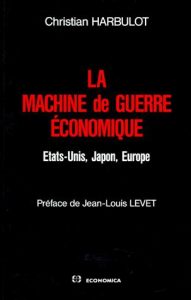« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. » Paul Eluard
La première fois que l’on y songe, le hasard semble avoir joué un rôle prépondérant. Si je ne m’étais pas arrêté à la Fnac ce jour-là, si je n’avais pas regardé attentivement les nouveautés et si mon œil n’avait pas été intrigué par ces lettres rouges sur fond noir, alors je n’aurais jamais rejoint l’école de l’intelligence économique. Cela fait beaucoup de « si » vous ne trouvez pas ?
La machine de guerre économique. Le sujet m’intrigua. En parcourant rapidement les pages, mon cerveau s’imprégna de quelques mots-clés : « renseignement », « dés-information », « intelligence », « influence ». Je regardais enfin la quatrième de couverture et la présentation de l’auteur : « Christian Harbulot est directeur des relations avec les entreprises à l’Association pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADITECH). Spécialiste des questions de guerre économique, il est à ce titre un des animateurs du groupe de travail « Intelligence Economique et Stratégies d’Entreprises » présidé par Henri Martre au Commissariat Général du Plan. Avec le cabinet STRATCO, il prépare pour janvier 1993 le lancement de la première école française d’intelligence économique ». Et c’est cette précision « il prépare pour janvier 1993 le lancement de la première école française d’intelligence économique » qui emporta ma décision. Finalement, l’acte d’achat tient parfois à peu de choses…
Le hasard ? Quelques années plus tard, je comprendrais que tout cela ne devait rien au hasard. Entre l’illusion du libre arbitre et la prison imaginaire du déterminisme, il existe un chemin. Celui du « deviens ce que tu es » des philosophes antiques que Spinoza et Nietzsche systématiseront. Le hasard, disait Sénèque, est la rencontre de circonstances et de dispositions. Mais reprenons. En un week-end, je dévorais littéralement cette « machine de guerre économique », moi qui d’habitude avais plutôt la lecture fastidieuse ! Un univers dont je soupçonnais l’existence venait de se dévoiler, un monde parallèle dont la presse parlait peu et nos éminents économistes pas du tout. Le lundi, je proposais d’ailleurs à mon enseignant d’économie d’entreprise de préparer un exposé pour la semaine suivante.. Reprenant pour le structurer les principaux schémas de l’ouvrage, je présentais ainsi sa thèse : « Les entreprises abordent aujourd’hui une nouvelle dimension de la concurrence internationale. Avec la fin des grands blocs militaires, la course à la puissance s’est déplacée du domaine géopolitique au terrain géo-économique. La concurrence s’exerce aussi bien entre groupes industriels, qu’entre respectivement blocs économiques, nations ou régions. Cette redistribution des cartes perturbe la réalité quotidienne des entreprises. Il ne suffit plus de bien produire pour vendre mais il faut aussi faire face aux différentes formes de menaces liées à la maîtrise de l’information, menaces sur les produits (contrefaçon, piratage de brevets, benchmarking, reverse engineering,…), menaces sur les sites et les personnes (espionnage industriel, piratage informatique, sabotage intelligent, manipulation des membres du personnage…), menaces sur l’environnement des entreprises (influence, désinformation, dérives mafieuses…). »
Ce même lundi matin – par une froide matinée d’hiver – je montrais l’ouvrage à un camarade de promotion. A peine sorti du Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN), il s’amusa de ma présentation de l’ouvrage avant de m’apprendre qu’il travaillait désormais avec… l’auteur du dit ouvrage. Le hasard encore ? Quelques jours après, Christian Harbulot venait simplement faire une conférence dans mon école de sciences politiques, place Saint-Germain-des-Prés. Le lieu était celui de la salle qui accueillit la première projection du cinématographe des frères Lumière. Mais surtout, cet imposant bâtiment qui donnait sur la rue Bonaparte abritait depuis le siècle précédent la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. Tout un symbole, non ?
La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. « La stratégie de reconquête du savoir technique de la France est orchestrée par Napoléon Ier en personne. Informé des risques que le blocus maritime anglais – contrepartie du blocus continental imposé par l’empereur – fait courir à notre économie, il décide de bâtir de toutes pièces une économie de combat contre la Grande-Bretagne. Ainsi naît la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) confiée à Chaptal. Ce Ministre a la particularité de cumuler les fonctions de ministre de l’Intérieur et de ministre de l’Industrie. La SEIN devient vite le centre nerveux d’un dispositif d’observation des découvertes et de l’organisation économiques des puissances rivales de la France. Napoléon veut tout savoir sur les points forts et les points faibles de l’économie britannique et il confie cette mission à la SEIN. Qui se souvient de l’existence de ce bâtiment en pierre de taille, situé au 4, place Saint-Germain-des-Prés ? Peu de chercheurs savent que derrière ses murs épais, ils peuvent encore consulter les premiers rapports d’étonnement d’un MITI à la française. » (Christian Harbulot, Jean Pichot-Duclos, La France doit dire non !, Plon pp 9-10.)
Mais revenons à notre histoire. Le rapport du Commissariat Général du Plan – dit rapport Martre du nom du président du groupe de travail – n’étant pas encore sorti (il sera disponible en février 1994 avec quelques mois de retard), l’intelligence économique est une expression quasi-inconnue. La conférence de Christian Harbulot s’intitule d’ailleurs plus simplement : « Le rôle de l’information économique ». En relisant les notes prises il y a vingt ans, je m’étonne encore de la pertinence de l’analyse et de la grille de lecture proposée.
L’intelligence économique, explique alors Christian Harbulot, consiste à savoir ce que fait l’autre. Trois champs d’activité la composent : la protection de l’information, les activités de veille et l’influence. Mais pour comprendre ce qui se trame réellement derrière le paravent idéologique de la libre concurrence, l’analyse doit prendre en compte quatre champs d’action ou échiquiers : le niveau mondial, le niveau régional, le niveau local et le niveau national. Au niveau mondial, c’est la logique de coopération qui prévaut. En raison de l’interdépendance croissante des économies, la question est de ne pas rentrer dans des confrontations qui amèneraient le système à s’auto-détruire. Mais il serait candide de s’arrêter aux discours des Etats, à l’instar du technoglobalisme japonais qui invite les autres pays à mieux faire circuler l’information scientifique… pour mieux la capter, intelligence oblige ! Au niveau régional, c’est-à-dire des grands blocs économiques que sont la CEE, l’ASEAN et l’ALENA, la compétition se réalise avant tout sur les normes et les lois. Les manœuvres souterraines trouvent sur cet échiquier un lieu de développement idéal. Et faut-il préciser que l’organisation européenne, anarchique et emplie d’intérêts contradictoires, n’est pas la mieux armée ? Au niveau local, force est de constater qu’il n’existe pas de modèle capitaliste unique mais des modèles qui s’opposent : un modèle rhénan et un modèle anglo-saxon. En ce qui concerne l’intelligence économique, le modèle rhénan démontre une supériorité écrasante. Regroupant des pays comme l’Allemagne, la Suède ou le Japon, il maille les acteurs et favorise la circulation de l’information stratégique. Guidés par un patriotisme économique qui ne dit pas toujours son nom, les Etats et les entreprises de ces pays savent travailler main dans la main dès lors qu’il en va de l’intérêt de puissance national. Le système ainsi mis en œuvre constitue une véritable machine de guerre économique. Citons pour exemples le réseau allemand de 6.000 sociétés de commerce ou son équivalent nippon, les sogo shosha. Fortes de plus de mille bureaux, ces sociétés de commerce recueillent en permanence des informations de base sur les produits et marchés mais aussi le contexte économique, politique et social des pays dans lesquelles elles opèrent. Mais la force du système est sa capacité de traitement au niveau du siège où de nombreux cadres et experts sont chargés d’analyser les données, de leur donner du sens et de les transmettre aux décideurs. Résultat : ce système d’intelligence économique privé rivalise avec les systèmes de renseignement économique et commercial mis en place par les Etats. Dis plus directement : la CIA est dépassée… sans compter que dans les pays du modèle rhénan, les banques jouent le jeu des entreprises nationales – notamment les PME ! – tout comme les syndicats qui savent favoriser la compétitivité de l’économie sans abdiquer leurs revendications face au patronat. Inimaginable en France ! Ce qui nous conduit au dernier échiquier, le national. Au sortir d’une guerre froide qui voit le triomphe du discours libéral se pose la question du rôle des Etats dans la compétition internationale. Il est frappant de constater que sur les quarante dernières années, le Japon et l’Allemagne sont les pays qui restent les plus fermés aux investissements étrangers mais également parmi les plus offensifs pour conquérir les marchés extérieurs. Fort d’un maillage dense entre acteurs publics et privés, ces puissances ont fait de l’information économique un levier de leur compétitivité. L’intelligence économique implique donc une culture du renseignement nationale, insiste le conférencier Et de ce point de vue, la France est très en retard. Aux Etats-Unis, le Futurologue Alvin Toffler sensibilise les élites au fait que le renseignement doit devenir l’infrastructure du savoir. Tandis qu’en France, on n’a toujours pas compris la véritable nature du renseignement, encore réduit à la réception d’un petit bout de papier dans un cabinet noir afin de connaître ce que prépare l’adversaire. Un chef avant de décider doit savoir. En France, un chef décide et après il se renseigne éventuellement pour vérifier si ce qu’il a décidé est correct. Mais si on lui démontre le contraire, il le rejette.
Pour conclure cette conférence, explique Christian Harbulot, tout le défi posé par l’intelligence économique est d’être capable d’ordonner les connaissances pour décider des actions à entreprendre, de créer une architecture cohérente afin de bien naviguer dans les différentes sources du savoir. Et si les entreprises commencent à pratiquer la veille technologique et la sécurité industrielle, elles ont encore beaucoup de difficultés à maîtriser les techniques d’influence et de lobbying. Dès lors de nouveaux métiers sont à inventer et des emplois vont apparaître. Nous sommes en 1993…